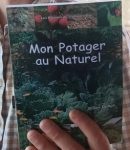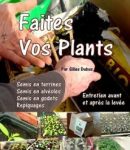La mouche des semis, également appelée mouche du haricot, est un petit insecte pouvant rapidement devenir un véritable fléau pour les jardiniers. Ses larves s’attaquent aux racines des jeunes plants, compromettant ainsi leur développement et leur survie.
Face à cette menace, de nombreux jardiniers se tournent vers des solutions radicales (rappelons que les traitements chimiques sont aujourd’hui interdits dans les jardins familiaux…), nocives pour l’environnement et la santé. Il existe cependant des alternatives naturelles tout aussi efficaces, respectueuses de l’écosystème.
Dans cet article, nous explorerons différentes méthodes pour prévenir et éventuellement traiter les infestations de mouches des semis.
Mais commençons par faire mieux connaissance avec cet insecte.
Qu’est-ce que la mouche des semis ?
La mouche des semis, connue sous son nom scientifique Delia platura, est un petit insecte discret, mais redoutable pour les jeunes semis potagers.
Elle appartient à la même famille que la mouche domestique, mais elle s’en prend essentiellement aux graines en germination et aux jeunes pousses.
Description de l’insecte

- L’adulte ressemble à une petite mouche grise de 5 à 6 mm, assez banale en apparence. On peut la confondre facilement avec d’autres mouches inoffensives.
- Comme très souvent avec les ravages au jardin, c’est la larve qui cause les dégâts. Elle a l’aspect d’un petit asticot blanchâtre, sans tête apparente, et sans pattes, et mesure environ 5 mm. Elle vit dans le sol et se nourrit des jeunes racines, cotylédons, tiges souterraines ou graines à peine germées.
- Les œufs sont très petits (moins d’1 mm), de couleur blanche. La femelle les ponds en surface du sol, près des graines ou des plantules.
Cycle de vie et périodes d’activité
Le cycle de la mouche des semis est rapide, surtout au printemps et en été :
- La femelle pond ses œufs directement dans le sol, privilégiant les lieux où l’humidité est élevée et avec de la matière organique en décomposition.
- En quelques jours, les œufs éclosent et donnent naissance aux larves.
- Les larves se nourrissent activement pendant environ 3 semaines, puis se nymphosent en adultes (ou, en fin de saison, en pupes pour passer l’hiver).
- Après la nymphose, de nouvelles mouches émergent, prêtes à recommencer le cycle.
Il peut y avoir plusieurs générations par an, en fonction de la météo, ce qui explique pourquoi les attaques peuvent être répétées durant toute la saison de semis.
Conditions favorables à la mouche des semis
Voici les conditions particulièrement appréciées par les mouches des semis :
- Les sols frais et humides ;
- La présence de matière organique fraîche, comme du fumier non décomposé ;
- Les printemps pluvieux ou frais, qui ralentissent la levée des semis, laissant plus de temps aux larves pour attaquer.
Quels sont les dégâts causés ?
La mouche des semis fait des ravages à un moment critique : juste après le semis, lorsque les graines commencent à germer ou que les jeunes plants sont encore très fragiles. Ce n’est donc pas l’insecte adulte qui est en cause, mais bien sa larve, qui vit et se nourrit dans le sol.
Plantes les plus touchées par la mouche des semis
La mouche des semis s’attaque à de nombreuses cultures potagères, notamment :
- Les légumineuses : haricots, pois ;
- Les légumes racines : radis, carottes, betteraves, navets, oignons ;
- Les salades, les choux et les épinards ;
- Parfois les courges, les concombres, les tomates, et même les pommes de terre.
En résumé, pratiquement toutes les jeunes plantules peuvent être concernées, surtout celles semées directement en pleine terre.
Symptômes visibles
Les dégâts sont souvent sournois, car ils se produisent sous terre, à l’abri des regards. Voici ce qu’on peut observer en surface :
- Non-levée des semis : les graines semblent ne jamais germer… en réalité, elles ont été mangées par les larves.
- Jeunes pousses flétries ou rabougries : les plantules lèvent, mais meurent rapidement, comme “coupées à la base”.
- Racines rongées : si on déterre les jeunes plants, on peut voir des racines attaquées ou des traces de galeries.
Ces symptômes peuvent aussi être causés par d’autres ravageurs (vers gris, taupins, limaces), mais la présence de petites larves blanches dans le sol sera alors un signe révélateur.
Différences avec d’autres ravageurs de semis
| Ravageur | Dégâts similaires | Différences |
| Limace | Plantules grignotées | Morsures visibles, bave, dégâts en surface |
| Taupin | Racines ou graines attaquées | Larve dure, jaune/orange, à tête foncée |
| Ver gris | Plantes coupées net | Larve plus grosse, grise, souvent enroulée dans la terre |
Pourquoi la mouche des semis est-elle redoutable au stade de la germination ?
Les jeunes plantes n’ont pas encore développé de système racinaire solide. Une seule larve peut suffire à détruire une graine en germination ou affaiblir un plant au point qu’il ne survive pas. Ce qui est frustrant, c’est qu’on ne voit rien venir avant qu’il soit trop tard.
Par ailleurs, les dégâts engendrés par la mouche serviront de “portes d’entrée” à diverses maladies ou autres ravageurs…
Comment reconnaître la présence de la mouche des semis au jardin ?

La mouche des semis agit de manière discrète, mais ses dégâts peuvent être bien visibles… quand il est déjà trop tard. Il n’est pas toujours facile de l’identifier au premier coup d’œil, surtout pour un jardinier amateur.
Voici donc quelques signes révélateurs et conseils pratiques pour détecter sa présence.
Indices à surveiller
- Semis qui ne lèvent pas : si vous avez semé il y a plus de 10 jours, que les conditions sont bonnes (chaleur, humidité), mais qu’aucune plantule ne sort… méfiez-vous.
- Jeunes pousses flétries ou mortes : des plantules qui lèvent puis fanent brusquement, comme si elles avaient été sectionnées au collet (la base de la tige).
- Présence d’asticots blancs dans la terre, près des graines ou des racines. Ils mesurent environ 5 mm, n’ont pas de pattes et sont légèrement translucides.
- Racines rongées ou cavités dans les graines : si vous fouillez un peu dans le sol et que vous trouvez des graines à moitié creusées ou des racines abîmées, c’est un indice fort.
Voici un petit test simple à faire : grattez délicatement la terre à l’endroit d’un semis qui n’a pas levé. Si vous y trouvez une graine molle, abîmée, et parfois accompagnée d’un petit asticot blanc, il y a de fortes chances qu’il s’agisse de la mouche des semis.
Quand être particulièrement vigilant ?
- Printemps (mars à juin) : période la plus risquée, surtout lors des semis précoces en pleine terre.
- Automne doux et humide : peut favoriser une deuxième vague d’attaques, surtout pour les légumes d’hiver (navets, épinards).
- Les conditions idéales pour elle : sol frais, humide, couvert de matière organique fraîche.
Moyens de prévention et de lutte contre la mouche des semis
Bonne nouvelle : il est tout à fait possible de réduire fortement les dégâts causés par la mouche des semis, en appliquant quelques bons gestes.
Mais, comme toujours, mieux vaut prévenir que guérir, car une fois les larves installées dans le sol, il est difficile de s’en débarrasser sans nuire au reste du jardin.
Voici un tour d’horizon des méthodes efficaces :
Prévenir l’infestation
Favorisez la biodiversité animale dans votre jardin

Les oiseaux insectivores (gobe-mouche, rouge-gorge, roitelet, étourneau, grive, merle, mésange, pic-vert, etc.) sont de formidables régulateurs de populations d’insectes, et notamment de mouche des semis. Pour les attirer dans votre jardin, plantez des haies diversifiées ou encore des plantes mellifères (attractives pour des insectes… qui fourniront donc de la nourriture aux oiseaux).
Dans le même ordre d’idée, grâce à un sol vivant et équilibré, les auxiliaires du sol (lombrics, carabes, staphylins) seront bien présents et réguleront naturellement les populations de larves nuisibles.
Laissez également une partie du jardin “sauvage” pour attirer ces précieux alliés.
Evitez les matières organiques fraîches
- Le compost mal décomposé ou le fumier frais attirent fortement les mouches.
- Privilégiez du compost bien mûr, ou incorporez les amendements plusieurs semaines avant les semis.
Semez dans des conditions de levées idéales
- Semez lorsque la terre est bien réchauffée (minimum 12-15°C minimum), pour favoriser une levée rapide des semis, ce qui limite leur exposition aux larves.
- De même, les semis lèveront plus vite si les graines sont placées à une profondeur adaptée à l’espèce (on considère une profondeur équivalente à environ 5 fois l’épaisseur de la graine – Je donne plus de précision pour chaque espèce légumière dans ma formation sur les semis directs au potager) .
- Évitez les périodes humides et fraîches prolongées.
Astuce : commencez vos semis en pépinière, à l’abri, puis repiquez les jeunes plants une fois bien développés. Cela leur donne une longueur d’avance sur les larves !
Évitez les excès d’humidité
Comme nous l’avons vu plus haut, un sol frais et humide est très apprécié par la mouche des semis.
Je ferais donc ici 2 recommandations :
- Dans des conditions d’humidité importante, que ce soit par le climat (région fraîche et humide), la météo du moment (période pluvieuse), et/ou le sol (lourd, retenant fortement l’eau), choisissez peut-être de semer en pépinière…
- Arrosez les semis modérément (le sol ne doit pas être détrempé) mais régulièrement (le sol doit resté humide le temps de la levée), et ce le matin de préférence (en tout cas au printemps, tant que les températures ne sont pas trop élevées – En période de canicule, je trouve préférable d’arroser le soir… mais c’est là un autre sujet).
Mettez en place une protection physique contre la mouche des semis
Installez un filet anti-insectes, ou éventuellement un voile P17, juste après le semis afin d’empêcher les adultes de pondre.
Ces protections pourront être retirées quelques semaines après la levée, lorsque les plants seront déjà développés et donc trop coriaces pour les larves de mouche… à moins que vous ne préfériez les laisser en place pour protéger vos cultures contre la mouche de la carotte par exemple…
En cas de semis sous abri ou en serre, veillez à bien aérer et surveillez l’humidité.
Associez les plantes
- Certaines plantes, comme la menthe, le basilic, le romarin ou encore la lavande peuvent tenir à distance, dans une certaine mesure, les mouches de semis.
- D’autres, comme les soucis notamment, les attireront au contraire, laissant les cultures potagères plus tranquilles.
Utilisez des répulsifs naturels
En préventif, des pulvérisations d’infusion de tanaisie sur le sol tiendront les mouches des semis éloignées des cultures à protéger.
De même, des pulvérisations de décoction d’absinthe, au moment des vols des mouches, pourront être utiles.
Vous pouvez aussi plus simplement pailler avec des feuilles de tanaisie ou d’absinthe. C’est un peu moins efficace que les pulvérisations, mais c’est aussi plus simple à mettre en œuvre et selon la situation, cela peut parfois suffire…
En cas d’attaque confirmée de mouche des semis
En appliquant les mesures présentées ci-dessus, vos cultures devraient normalement être préservées d’attaques massives.
Mais, si cela venait tout de même à se produire, voici comment vous pouvez procéder :
Retirez les plants atteints
- Évitez de laisser les plantules infestées en place : cela favorise la survie des larves.
- Détruisez les plants malades loin du potager (ne les mettez pas au compost… les larves y prospéreraient !).
Utilisez des nématodes
Des nématodes spécifiques pour la mouche des semis sont proposés sur le marché. N’agissant que sur la larve de cet insecte, c’est je pense la solution radicale la moins nocive pour la biodiversité.
Semez à nouveau en conditions plus sèches ou protégées
- Attendez que le sol se réchauffe et sèche légèrement pour refaire un semis.
- Vous pouvez aussi semer en pépinière, en godets à l’abri et repiquer plus tard.
Les méthodes radicales que je ne recommande pas
Je présente les solutions suivantes pour être le plus complet possible. Mais, bien que ces produits soient autorisées en agriculture biologique et dans les jardins familiaux, je ne les recommande absolument pas… car ils nuisent à la biodiversité et donc aux équilibres naturels (et risquent à terme d’engendrer encore plus de dégâts dans vos cultures).
Utilisez (ou pas) des insecticides naturels, en dernier recours
Certains insecticides bio à base de pyrèthre sont parfois recommandés… Mais en réalité, les larves se trouvant dans le sol, ils ont peu de chance de pouvoir les atteindre… Et surtout, ils ne sont absolument pas sélectifs… Ce qui veut dire que de nombreux insectes, y compris certains considérés comme auxiliaires y succomberont… À éviter donc.
(N’) utilisez (pas) les pièges jaunes englués
Posés à proximité des zones de semis, ces pièges jaunes (la couleur attractive pour les mouches, entre autres…) attirent et capturent (avec la glu) les mouches adultes. Cela permet de repérer une infestation, voire de limiter leur reproduction. Pas mal me direz-vous… Oui, en théorie.
Mais ces pièges présentent aussi un inconvénient majeur : ils ne sont pas sélectifs et élimineront donc toute une faune utile (sachant que tout animal joue de toute façon un rôle au sein de la biodiversité).
La mouche des semis est embêtante, mais on peut facilement limiter ses dégâts avec un peu d’attention et de prévention !
Vos partages d’expérience, vos astuces et vos questions sur le sujet (pour d’autres sujets, utilisez le champ de recherche SVP… et posez vos questions sur un article approprié) sont attendus ci-dessous.